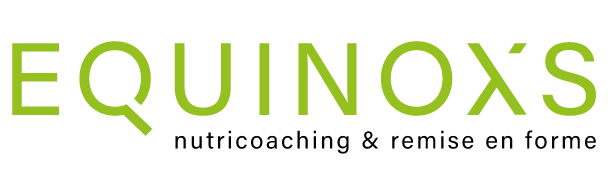Peut-on devenir dépendant au stress ?
Article rédigé par Anne-Christine DUSS – Nutritionniste, Genève
Quand le cerveau transforme l’anxiété en addiction
Le stress est souvent perçu comme un ennemi : accélération du rythme cardiaque, tensions musculaires, pensées envahissantes, insomnie. Pourtant, certaines personnes semblent rechercher cet état de tension, comme si leur organisme avait besoin de ce carburant pour avancer. Derrière ce paradoxe se cache une réalité neurobiologique : le stress et l’anxiété peuvent, au même titre que certaines drogues ou comportements, devenir addictifs.
Plongeons dans les coulisses des neurotransmetteurs et des hormones qui transforment l’alerte en dépendance.
1. Le stress : un mécanisme de survie détourné
À l’origine, le stress est une réaction d’adaptation. Face à une menace, l’organisme active l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHS) et le système nerveux sympathique. Résultat : libération d’adrénaline, de noradrénaline et de cortisol.
Ces substances déclenchent une cascade physiologique :
- augmentation du rythme cardiaque,
- mobilisation du glucose,
- hypervigilance,
- mise en sommeil des fonctions secondaires (digestion, reproduction).
Dans un contexte de danger réel, cette réponse est salutaire. Mais dans nos sociétés modernes, les menaces sont souvent psychologiques (examens, pression professionnelle, conflits relationnels). Le cerveau active pourtant les mêmes circuits que face à un prédateur… sauf que cette activation peut devenir chronique.
2. Adrénaline et noradrénaline : le shoot d’urgence
L’adrénaline et la noradrénaline sont les premières messagères du stress. Elles augmentent la vigilance et l’énergie disponible. Sur le plan subjectif, elles procurent une sensation de puissance, de lucidité, parfois même d’euphorie.
Cette montée ressemble à un shot d’adrénaline recherché par les sportifs extrêmes ou les amateurs de sensations fortes. Le problème : le cerveau s’y habitue. Plus le stress devient fréquent, plus il faut de stimulation pour obtenir la même intensité d’activation.
C’est là que se met en place un phénomène d’accoutumance. Sans tension, la personne peut se sentir amorphe, voire déprimée. Inconsciemment, elle va alors chercher à recréer des situations stressantes.
3. Dopamine : quand le stress active le circuit de la récompense
La dopamine est le neurotransmetteur phare de la motivation et de la récompense. Elle intervient lorsque nous atteignons un objectif, découvrons quelque chose de nouveau ou prenons un risque.
Or, le stress – surtout aigu – stimule aussi le système dopaminergique. C’est contre-intuitif, mais le cerveau peut associer l’état d’alerte à une récompense :
- “Sous pression, je suis performant.”
- “Avec l’adrénaline, je me sens vivant.”
- “Dans l’urgence, je réussis mieux.”
Petit à petit, la dopamine renforce le conditionnement : le stress devient non seulement toléré, mais recherché. Comme une drogue, il crée une boucle où l’organisme anticipe une récompense chaque fois qu’une situation anxiogène survient.
4. Cortisol : le ciment de la dépendance
Le cortisol, hormone du stress sécrétée par les surrénales, agit plus lentement que l’adrénaline mais ses effets sont profonds. Il mobilise les réserves énergétiques, régule l’inflammation, mais surtout il influence la plasticité cérébrale.
Un excès chronique de cortisol :
- renforce l’amygdale, centre de la peur et de l’anxiété, rendant la personne plus réactive,
- affaiblit l’hippocampe, zone clé de la mémoire et de l’inhibition des peurs,
- perturbe le cortex préfrontal, siège de la prise de recul et de la rationalité.
Cette triade entretient un cercle vicieux : plus le stress est présent, plus le cerveau devient câblé pour réagir par… encore plus de stress. On entre dans une forme de sensibilisation neuronale, analogue à ce qui se produit dans les addictions aux substances.
5. GABA et sérotonine : les freins qui lâchent
Normalement, l’organisme possède des neurotransmetteurs apaisants :
GABA (acide gamma-aminobutyrique), principal frein du système nerveux central,
sérotonine, impliquée dans l’humeur, le sommeil et la régulation émotionnelle.
Sous stress chronique, leur efficacité diminue :
- les récepteurs GABA deviennent moins sensibles → l’inhibition naturelle s’effondre,
- la sérotonine chute → humeur instable, anxiété accrue.
C’est comme si la voiture du stress n’avait plus de freins efficaces. Résultat : le cerveau roule en surrégime, ce qui augmente la dépendance à l’état d’alerte.
6. Le cycle de l’addiction au stress
On peut résumer la dépendance au stress en quatre étapes :
- Activation : un stress déclenche adrénaline, dopamine et cortisol → énergie, vigilance, sentiment de contrôle.
Renforcement : la dopamine associe cette activation à une récompense → le cerveau apprend que “le stress fait du bien”. - Accoutumance : avec le temps, le seuil de tolérance monte → il faut plus de pression pour ressentir la même stimulation.
- Manque : sans stress, la personne ressent fatigue, vide, anxiété → elle provoque inconsciemment des situations stressantes pour combler ce manque.
Ce cycle reproduit fidèlement celui des addictions comportementales (jeux d’argent, sport extrême) ou chimiques (caféine, amphétamines).
7. Les comportements révélateurs
Certaines attitudes du quotidien révèlent cette dépendance :
- procrastiner jusqu’à la dernière minute pour ressentir le “coup de boost” de l’urgence,
- multiplier les projets, tâches ou responsabilités pour maintenir un niveau de tension élevé,
- rechercher les conflits ou s’exposer à des environnements anxiogènes,
- se sentir “vide” ou déprimé en période de calme ou de repos.
La dépendance au stress ne se limite donc pas aux cadres surchargés : elle peut toucher étudiants, sportifs, artistes, ou toute personne qui associe inconsciemment anxiété et efficacité.
8. Les conséquences à long terme
Si le stress aigu peut être stimulant, le stress chronique est délétère :
- épuisement (burn-out),
- troubles du sommeil,
- anxiété généralisée,
- dépression,
- maladies cardiovasculaires,
- affaiblissement immunitaire.
Le paradoxe est que le cerveau “accro” au stress se détruit progressivement en cherchant sa dose. Le système devient incapable de fonctionner de manière équilibrée, ce qui aggrave la dépendance.
9. Sortir du piège : rééquilibrer les neurotransmetteurs
Comprendre que le stress peut devenir une addiction est déjà un premier pas. Mais comment rétablir l’équilibre ?
a) Stimuler le GABA et la sérotonine
- méditation, respiration profonde, yoga,
- activité physique régulière,
- alimentation riche en tryptophane (précurseur de la sérotonine : œufs, noix, légumineuses) et en magnésium.
b) Réapprendre la récompense sans stress
- cultiver des sources de dopamine alternatives : apprentissage, créativité, interactions sociales, musique.
- renforcer le système de récompense par des petits objectifs atteignables hors contexte stressant.
c) Réduire le cortisol
- sommeil de qualité,
- contacts sociaux sécurisants,
- nature et lumière naturelle,
- pauses régulières dans la journée.
d) Rééduquer le cerveau au calme
Le plus difficile pour une personne dépendante au stress est d’accepter l’ennui ou le calme. C’est pourtant essentiel pour rééquilibrer le système. Des techniques progressives de relaxation ou de pleine conscience peuvent aider à tolérer puis apprécier les états de repos.
Conclusion
Devenir dépendant au stress n’est pas une simple métaphore : au niveau neurobiologique, les mécanismes en jeu sont comparables à ceux des addictions classiques. Adrénaline, dopamine et cortisol fournissent un “shoot” de stimulation, tandis que GABA et sérotonine, censés calmer le jeu, perdent leur efficacité.
Le résultat : un cerveau qui réclame du stress pour fonctionner, quitte à s’auto-saboter pour recréer les conditions de tension.
Sortir de ce cercle vicieux demande de réapprendre au système nerveux à trouver de la récompense et de l’énergie ailleurs que dans l’anxiété. Cela passe par des changements de mode de vie, une hygiène émotionnelle, et parfois un accompagnement thérapeutique.
En reconnaissant le stress comme une potentielle addiction, on ouvre une voie nouvelle pour comprendre nos comportements, nos dépendances invisibles et nos difficultés à lâcher prise.
À lire aussi …
Accueillir ses émotions : Les clés d’une meilleure compréhension de nos comportements et ressentis
Pilates pour l’esprit : techniques pour renforcer la santé mentale et la résilience émotionnelle